
Taïwan : une île ou la complication géopolitique règne
L’île de Taïwan est confrontée, depuis mi-octobre, à une menace militaire chinoise. Leurs désaccords politiques et les enjeux diplomatiques ne font que complexifier ce conflit déjà bien ancien.
Taïwan fait face, depuis de nombreuses semaines, à une forte pression, quasi-quotidienne, de la part de la Chine. Cela engendre de multiples tensions entre les deux pays. Ces divergences remontent à la défaite des nationalistes face aux communistes en 1949.
Aujourd’hui, ces tensions sont plus que présentes. Elles s’expliquent par l'arrivée au pouvoir, le 20 mai 2024, du président taïwanais Lai-Ching-Te. Ce dernier est membre du Parti démocrate progressiste et est jugé dangereux par la Chine.
L’empire du milieu, lui, pense que Taïwan reste une province chinoise à part entière. Il l’affirme grâce au principe de « la Chine unique » reposant sur l’idée que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine et qu’elle sera un jour réunifiée entièrement. Pékin estime pouvoir recourir à la force si nécessaire pour contrôler l’île.
Une accélération militaire plus qu’actuelle
L’intensification des exercices militaires chinois est une réponse de Pékin au discours du président Lai-Ching-Te tenu le 10 octobre. Le dirigeant taïwanais, explique que « la République populaire de Chine n’a pas le droit de représenter Taïwan » et que « depuis le début, la République de Chine fait preuve d’une détermination inébranlable ; et [que] depuis le début, le peuple de Taïwan fait preuve d’une ténacité inébranlable »(insidetaiwan.net). Cette déclaration est considérée comme « indépendantiste » et « séparatiste » par la Chine. Pékin met alors la pression sur Taïwan avec des manœuvres à grandes échelles avec un record d’avions et de navires autour de l’île.
Entre le 13 et 14 octobre, la Chine a exécuté deux missions autour de l’île. Une navigation d’un porte-avions au sud, et un décollage de quatre avions de chasse près de la base d’Hinschu. Mardi 22 octobre, la deuxième puissance mondiale continue sa pression militaire en entamant un exercice à munition réelle à une centaines de kilomètres de la province de Fujian. Les soldats chinois tirent pendant 4 heures à partir de 9 heures dans une zone d’environ 150 kilomètres carrés. Les autorités taïwanaises déclarent à Ouest-France que « les exercices menacent la paix et la stabilité régionale » et que « le ministère surveille de près les activités et intentions de la Chine ». Le 3 novembre, Taïwan détecte 37 avions et drones chinois dans son espace aérien. Le gouvernement décide alors de déployer des avions, des navires et un système de missiles à terre. Le président taïwanais réagit dans Le Monde « face aux menaces extérieures, le gouvernement continuera de défendre le système constitutionnel de la démocratie libre ».
Un monde diplomatique impliqué dans cette affaire
À l’échelle internationale, on ne parle pas de tensions ni d’abus mais « d’ambiguïté stratégique ». L’objectif est de ménager la Chine tout en gardant Taïwan comme allié stratégique.
Les relations entre l’Union Européenne et Taïwan se renforcent. Lors de la réunion parlementaire européenne, jeudi 24 octobre, les députés ont annoncé plusieurs faits. Ils ont d’abord alerté sur les différentes tentatives chinoises de contournement du droit international de Taïwan. Ils ont ensuite condamné les provocations militaires de l'État chinois. Les parlementaires ont également rejeté les modifications du statu-quo dans le détroit de Taïwan. Ils ont fini par demander à l’ONU d’accorder, aux ressortissants taïwanais et aux journalistes, le droit d’accéder à leurs locaux en toute sécurité.

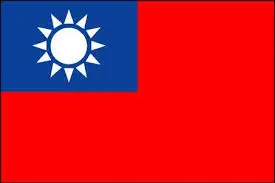
Les États-Unis maintiennent cette « ambiguïté stratégique ». Ils s’engagent à vendre des armes à Taïwan. L’objectif est de garantir la défense du gouvernement taïwanais face à la puissance chinoise. Les USA s’abstiennent toutefois de dire s'ils interviendront ou non militairement pour défendre Taïwan en cas d’invasion.
Les relations diplomatiques entre Taïwan, la Chine et les États-Unis risquent d'évoluer avec l’arrivée du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Le gouvernement taïwanais a peur de perdre le soutien capital des américains sur la logique transactionnelle du président Trump.