« C’était compliqué d’appeler mes chefs et de leur dire que je voulais rentrer, alors qu’il ne s’était rien passé. » : l’interview de Simon Fichet
Journaliste reporter d’images pour France TV, Simon Fichet a sorti son premier livre, Tornade. À la poursuite du monstre des plaines américaines, en août 2024. Il y raconte un tournage mené, en 2015, dans un milieu qu’il ne connaissait pas : celui des chasseurs de tornades.
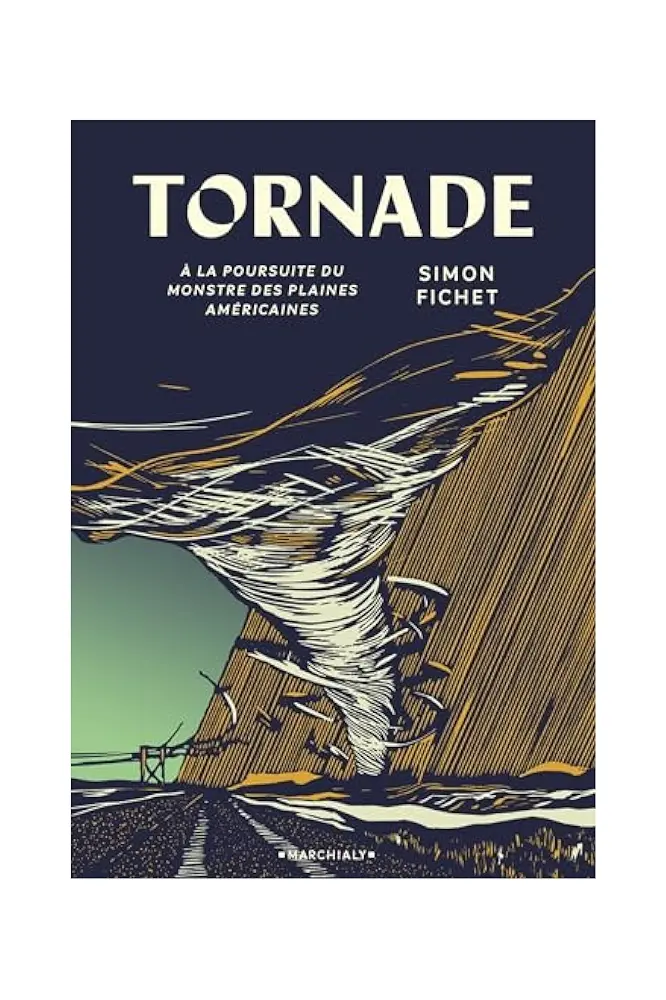
C’est sans prendre le temps de faire une recherche sur internet qu’il a accepté la proposition de reportage de son collègue Alexandre Paré. L’objectif : réussir à filmer une tornade pour le 13h15 de France 2. Plus facile à dire qu’à faire. Simon Fichet comprend rapidement que cette virée ne sera pas de tout repos, il est à deux doigts de se désister. Mais, la honte de faire marche arrière le pousse à embarquer, à contrecœur, direction la Tornado Alley. Accompagné d’Alexandre et de deux chasseurs d’orages français, Laetitia et Mathieu, il s’apprête à vivre une expérience qui ne le laissera pas indifférent.
2015, vous apprenez que vous allez suivre des chasseurs de tornades, sujet sur lequel vous ne vous étiez jamais vraiment penché. Comment avez-vous préparé ce tournage assez spécial ?
En tant que caméraman, j’avais une responsabilité particulière d’un point de vue technique. J’ai fait très attention à ce qu’on devait prendre comme matériel, parce qu’il pouvait y avoir de la casse. Sinon, j’ai essayé de me tenir au courant, comme d’habitude. Sur ce sujet-là, j’ai surtout regardé des vidéos, mais ça a été contre-productif puisque c’est parce que j’ai commencé à regarder un peu ce que faisaient les chasseurs de tornades que j’ai angoissé.
Quand vous arrivez aux Etats-Unis, cette angoisse ne vous lâche plus. Comment, en tant que journaliste, réussissez-vous à garder une distance professionnelle avec ce que vous êtes venu documenter ?
J’ai essayé comme tout le monde de me raisonner. Le plus souvent ce qui m’arrive, c’est d’avoir des bouffées d’émotions pendant le tournage parce qu’on est témoin de choses tristes. Là, c’était différent puisqu’il ne se passait rien de grave, et pourtant je me suis mis à angoisser. Ce qui est compliqué, c’est que ça ne doit pas polluer les autres dans l’équipe. Il faut réussir à faire la distinction entre le fait qu’il se passe vraiment quelque chose de dangereux, et là, où il n’y avait pas de raison d’angoisser. Maintenant que nous y étions, c’était compliqué d’appeler mes chefs et de leur dire que je voulais rentrer, alors qu’il ne s’était rien passé.
Qu’est-ce qu’il se passe dans votre tête lorsque vous vous retrouvez, pour la première fois, face à une tornade ?
Au fur et à mesure des jours c’est presque un jeu qui s’est mis en place, et au moment où on est devant, il y a pleins d’émotions qui s’emmêlent : la peur qu’elle fonce sur nous, la joie de la voir après tout ce temps, le soulagement de se dire que c’est fini, qu’on va rentrer. Mais, c’est aussi un phénomène fascinant, hypnotisant, et je sais qu’à cet instant, il y a peu de chances que j’en voie d’autres dans ma vie. Malgré le danger, il faut quand même en profiter. Tout ça au même moment, dans les mêmes secondes. Une sorte de melting-pot d’émotions.

À gauche, Simon Fichet qui filme et son collègue Alexandre Paré. En face, Greg Johnson, leader des Tornado Hunters [© Laetitia Gibaud]
Une fascination qui anime les chasseurs de tornades. Pensez-vous qu’ils gardent tout de même en tête que cela n’est pas qu’un divertissement ?
C’est vrai qu’il y a une ambivalence chez les chasseurs de tornades, qu’ils peinent eux-mêmes à expliquer : ils sont fascinés par un phénomène météo, que l’on a normalement tendance à fuir, et qui est potentiellement destructeur, voire meurtrier. Quand on leur demande, chacun a un discours différent, et ça peut les mettre mal à l’aise. Mais, la plupart d’entre eux expliquent qu’ils essaient de rester sur le phénomène météorologique. Ils ne photographient jamais de victimes, de maisons détruites, et s’ils sont témoins de quelque chose de grave, ils portent assistance.
D’un autre côté, comment les victimes perçoivent elles les chasseurs de tornades ?
Aux USA, comme les storm chasers sont quelque chose d’assez commun, il y a beaucoup de programmes télévisés qui parlent de ça. C’est drôle, les gens sont quand même assez amusés et fascinés par eux. Je n’ai pas senti d’animosité, ils ne sont pas perçus comme des personnes qui ont une passion déviante.
Vous expliquez, dans votre livre, que vous avez rencontré Roger Hill (détenteur du Guiness record de l’homme qui a vu le plus de tornades) qui emmène des touristes dans la Tornado Alley. Du fait que le phénomène des storm chasers soit très répandu, avez-vous eu l’impression qu’un business se crée autour de cet engouement ?
C’est un phénomène qui est en expansion, parce que maintenant même des Français proposent d’emmener des touristes avec eux là-bas. Ça leur permet de se faire un peu d’argent, mais c’est surtout pour financer le voyage sur place, comme les Américains finalement. Chasser des tornades, c’est une passion qui coûte cher. Ils dorment dans des hôtels pendant deux mois, font des milliers de kilomètres, sans compter le matériel photographique. On pourrait croire aussi qu’ils vendent leurs photos aux chaînes de télé, ou de météo, mais très souvent ils les donnent gratuitement. C’est sûr que ça leur fait un peu de pub, avec leur nom qui s’affiche à l’écran. Derrière sur leurs réseaux sociaux, ils vont peut-être vendre des affiches etc. Mais personne ne devient riche en vendant des photos de tornades.
Au-delà de cela, c’est aussi une compétition avec la nature, réussir à capturer quelque chose que l’on ne contrôle pas. On pourrait penser à tort qu’en étant assis la plupart du temps, dans une voiture, chasser des tornades est plutôt tranquille. Or, vous y avez laissé quelques kilos, vous et votre collègue Alexandre…
Le problème c’est que la Tornado Alley est très grande. Entre le moment où on se lève vers 8h, et celui où on arrive sur un orage en fin de journée, on peut faire 800km. À ça, il faut aussi ajouter les 200-300km que l’on fait avec l’orage qui se déplace, en sachant que c’est de la conduite dangereuse, mais aussi les 500km, pour se repositionner en vue du lendemain. La journée se finit vers 1h du matin, on dort 5-6h et c’est reparti. Tout ça pendant quinze jours. À un moment, on ne comprend plus rien. En rentrant j’ai fait une nuit de 17h, j’étais vraiment épuisé. Ceux qui partent un mois ou deux doivent être HS.

[© Laetitia Gibaud]

[© Laetitia Gibaud]
Diriez-vous que c’est le tournage le plus éprouvant de votre carrière ?
Oui, le plus fatiguant et le plus fou. La semaine dernière, je suis allé en montagne avec un vidéaste animalier (13h15 : Sur la piste des loups). On a marché pendant 15km avec le matériel, donc c’est sûr que c’est fatiguant. Mais souvent les tournages habituels durent un ou deux jours. Là, le fait que ce soit quinze jours, tout le temps sur le pont, avec très peu de sommeil, c’est quand même assez rare.
Et quelles traces cette expérience a-t-elle laissées dans votre relation avec Alexandre ?
En télévision, on part souvent en équipe. Ce qui peut avoir des mauvais côtés parce qu’on peut ne pas s’entendre, mais très souvent ça développe des relations assez fortes. Quand on part sur des terrains compliqués, comme c’est le cas pour la guerre ou pour les tornades, sur des histoires difficiles, des faits divers, on se retrouve embarqués ensemble dans la même galère. Les discussions qu’on peut avoir à ce moment-là sont très importantes. Avec Alexandre, on a fait un premier tournage ensemble à Ferguson puis, derrière, on est reparti sur les tornades et pour un reportage sur Trump. C’est sûr qu’avec ces heures et ces heures de voiture, on finit par parler de choses intimes qu’on ne dirait pas si on était juste au bureau. Tout ça nous a beaucoup liés, et malgré tout, on aurait pu se disputer aussi parce que ça peut être très tendu.
À votre retour en France, vous décrivez un moment assez compliqué puisque l’angoisse vous poursuit alors que tout est fini. À quel point les tornades vous ont-elles hanté, et est-ce que ça en est fini aujourd’hui ?
En rentrant en France, je pensais être soulagé, mais en fait pas du tout. Je n’avais pas forcément peur qu’une tornade revienne, même si je décris une scène pendant l’été où j’ai peur qu’il y en est une qui se forme. C’était surtout ce qui pouvait être lié à un phénomène naturel non maîtrisable qui me faisait peur. C’était plus fort que moi, une forme de stress post-traumatique. À l’époque, j’allais chez le psy. Je lui en ai parlé, mais il ne prenait pas ça au sérieux. C’est peut-être pour ça que je me suis mis à écrire un livre. J’avais besoin de comprendre ce que j’avais vu là-bas. Aujourd’hui ça va beaucoup mieux, le temps a fait son affaire.
En lisant votre livre, on prend conscience des conséquences que le métier de journaliste peut entraîner sur la santé mentale. Au-delà de cela, vous avez travaillé sur des sujets particulièrement sensibles comme les attentats de 2015, diriez-vous que le suivi psychologique des journalistes est quelque chose d’important ?
Beaucoup de mes collègues vont chez le psy ponctuellement ou sur du long terme pour décompresser. Il y a moins de tabous autour du fait d’y aller dans notre profession, que dans d’autres corporations. Les rédactions et les entreprises en ont conscience aussi et proposent parfois des debriefs dès que des journalistes reviennent de tournages compliqués. Ce qui peut être problématique c’est quand le journaliste lui-même ne voit pas qu’il va mal parce qu’un reportage l’a marqué.
Même si, à l’origine, votre livre n’avait pas une vocation thérapeutique, l’écriture vous a tout de même aidé à surmonter définitivement votre angoisse. Aujourd’hui, après avoir vécu toute cette expérience, seriez vous capable de repartir dans la Tornado Alley ?
Pendant longtemps, j’aurais répondu non. Aujourd’hui, maintenant que le livre est fini, je répondrais oui mais à certaines conditions. Par exemple, oui si j’y vais pour le plaisir et que je sens que je n’ai pas une obligation de résultats. Le problème du tournage pour France 2, c’est qu’on avait promis qu’on ramènerait une tornade, et que c’était compliqué de rentrer bredouille. Si par contre demain je repars avec des chasseurs en me disant que s’il y a trop de danger, on peut faire demi-tour, ça me va. Parce que c’était quand même très beau ces orages sur des plaines immenses, avec des couleurs de dingue. Ça reste dans la tête. C’est dur de se dire qu’on ne reverra jamais des images pareilles.
Léonie DENET